Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur : chef d’oeuvre à voix d’enfant
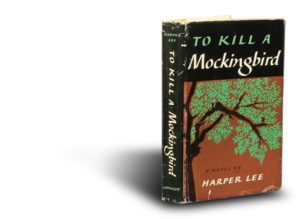
Certains livres intriguent. Par leur titre, par leur destin ou celui de leur auteur.e, par leur notoriété, tout simplement par leur contenu …
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur fait partie de cette catégorie : tout d’abord, qui voudrait tirer sur un oiseau moqueur ? (Au fait, quelle sorte d’oiseau est-ce donc ?)
Pourquoi ce livre, pas si connu que ça en France, est un grand classique aux Etats Unis, trônant bien en vue dans chaque librairie un tant soit peu conséquente, lu par nombre de collégiens et lycéens à travers le pays depuis deux ou trois générations (état de fait apparemment régulièrement remis en question, voir l’article paru dans Actualitté en 2017 https://bit.ly/2YuLWBc) ?
Pourquoi Harper Lee, son auteure, n’a t-elle plus écrit aucun livre pendant des décennies, suite à ce coup de maître récompensé par le Prix Pulitzer en 1961 ?

Il était temps de mener l’enquête, ce que j’ai fait au printemps, me plongeant dans sa lecture sans pouvoir le lâcher, ensorcelée par l’histoire de Scout, Jem, Dill, Boo Radley, Atticus Finch, Calpurnia, Miss Maudie, Tom Robinson et les affreux Ewell …
Maycomb, Alabama, années 1930
Nous voici à Maycomb, petite bourgade assoupie de l’Alabama dans les années 1930. Scout, gamine vive et dégourdie, vit pour l’été et tout ce qu’on peut y découvrir. Avec son frère Jem et Dill, garçon mythomane, qui cache derrière son ton hâbleur et ses mensonges sa tristesse d’enfant mal aimé, elle explore, expérimente, tchatche, se cogne (scène impressionnante où elle roule à l’intérieur d’un pneu lancé à toute vitesse dans la rue), teste les limites de son monde, clairement circonscrit entre les maisons des Radley, de miss Maudie et de la grincheuse Madame Dubose.
Les journées s’étirent, sources infinies de jeux, d’émotions fortes et de frissons. Car les enfants font une fixation sur un de leurs voisins, le mystérieux Arthur « Boo » Radley, sujet de tous leurs fantasmes : existe-t’il vraiment ? Est-il un fantôme vengeur ? Pourquoi ne sort-il jamais de chez lui ? Leurs tentatives pour le prendre par la ruse (Dill propose l’ingénieuse idée de laisser une traînée de jus de citron depuis la porte arrière jusqu’à la véranda, que Boo Radley suivrait comme une fourmi. Idée non concrétisée) sont régulièrement déjouées par les adultes qui les entourent : Calpurnia, leur gouvernante noire, à l’affection sévère, Atticus Finch le père, veuf, avocat intègre et droit, perdu dans ses livres ou ses pensées, à la parole rare mais précieuse, Miss Maudie, la voisine pleine de sagesse, ou leur tante Alexandra, arrivée en renfort au grand désarroi de Scout (dont le vrai prénom est Jean Louise), qui ne sait pas comment se comporter devant cette maîtresse femme :
Je ne savais pas quoi lui dire d’autre. D’ailleurs, je ne trouvais jamais rien à lui dire, et je m’assis en songeant aux laborieuses conversations que nous avions eues par le passé :
« Comment vas-tu, Jean-Louise ?
– Bien, merci ma tante, et vous ?
– Très bien, merci ; que deviens-tu donc ?
– Rien.
– Tu ne fais rien ?
– Non, ma tante.
– Tu as bien des amis ?
– Oui, ma tante.
– Et que faites-vous ensemble ?
– Rien. »
A l’évidence, elle me trouvait assommante.
Car leur monde, fait de jeux et de petits drames (l’entrée à l’école pour Scout et l’ennui qu’elle retire de ces journées) vole en éclat quand l’extérieur fait irruption. L’extérieur, c’est la mission qui incombe au père, Atticus, de prendre la défense d’un Noir injustement accusé du viol d’une Blanche. Dans l’Alabama ségrégationniste, cet événement va bien évidemment secouer la petite ville, durcir les relations, révéler la noirceur ou la grandeur de chacun(e) et avoir des conséquences sur les deux enfants d’Atticus, qui découvrent par la même occasion la réalité du racisme.
Jean Louise Finch, dite Scout
Il faut un talent rare pour arriver à parler à voix d’enfant, en se mettant vraiment dans la peau de celui qu’on a été, plus encore dans l’enfant fictif que l’on a créé. Il y a une manière de présenter la réalité, onirique, crue, lucide, pleine de bon sens, drôle, oubliée, la plupart du temps. C’est le premier tour de force de Harper Lee, écrivain.e discrète qui raconte le bled fictif d’Alabama, Maycomb, comme un univers foisonnant quoique sur le déclin, où l’arrivée d’un chien enragé est décrite comme une scène du film « Le train sifflera trois fois », où il se passe tellement peu d’événements « réels » – jusqu’au coup de tonnerre de l’accusation de viol puis du procès – en comparaison de la richesse des jeux et de l’imagination du trio Scout – Jem – Dill, avec leur sujet de prédilection : Boo Radley, le voisin invisible – et donc effrayant.
Jem fit une description plausible de Boo : il mesurait près de deux mètres, à en juger par ses empreintes ; il mangeait des écureuils crus et tous les chats qu’il pouvait attraper, ce qui expliquait que ses mains soient tâchées de sang – si on mangeait un animal cru, on ne pouvait jamais en enlever le sang. Une longue cicatrice lui barrait le visage ; pour toutes dents, il ne lui restait que des chicots jaunes et cassés. Les yeux lui sortaient des orbites et il bavait presque tout le temps.
– Essayons de le faire sortir, lança Dill. Je voudrais savoir à quoi il ressemble.
Jem dit que s’il tenait à se faire tuer il lui suffisait d’aller frapper à sa porte.
Notre premier raid se produisit parce que Dill paria « Le Fantôme Gris » contre deux « Tom Swift » que Jem n’oserait jamais franchir la grille des Radley. Et Jem relevait toujours les défis.
Il y réfléchit pendant trois jours. Je suppose qu’il préférait l’honneur à la vie parce que Dill trouva vite l’argument décisif.
Le premier jour il lui dit :
– Tu as peur.
– Non, je suis poli, répondit Jem.
Le deuxième jour il lui dit :
– Tu as tellement peur que tu n’oserais même pas poser un pied dans leur jardin.
Jem répondit que c’était faux puisqu’il passait devant chez les Radley tous les jours pour aller à l’école.
– Toujours en courant, précisais-je.
Le troisième jour, Dill l’emporta en affirmant que les habitants de Meridian étaient moins froussards que ceux de Maycomb.
Les relations de Jean Louise avec son grand frère Jem, faits d’adoration, de vacherie, d’agacement et de complicité fusionnelle sont très bien rendus. Son amitié naïve et forte avec Dill, son « fiancé » de l’été, également.
« Salut, Boo »
Le symbolisme du personnage de Arthur Radley, « Boo Radley », comme l’appellent les enfants est superbement maîtrisé, comme un pendant allégorique des événements réels qui secouent Maycomb et ses habitants. Car une des origines du racisme, n’est-ce pas l’incapacité de voir l’autre tel qu’il est, de le comprendre, de l’accepter dans son altérité ?
Au début du livre, Boo Radley est décrit comme un monstre dangereux et fait l’objet de racontars sans fin entre Jem, Scout et Dill. Il personnifie en quelque sorte la Peur, l’Inconnu, le Danger. Car on ne le voit jamais, il ne sort jamais (Tout le monde eût volontiers reçu les Radley, mais ils ne sortaient jamais, manière de vivre impardonnable dans une petite ville). Il attise donc la curiosité et les frissons (Il sort, tu sais, quand il fait complètement noir. Miss Stéphanie Crawford raconte qu’elle s’est réveillée une fois, en pleine nuit, et qu’elle l’a surpris à la regarder à la fenêtre … que sa figure ressemblait à une tête de mort). Les enfants sont tellement dans leur « storytelling » que rien ne vient contrebalancer l’échafaudage mental qu’ils se sont créés. Pas même les touchantes attentions que Boo a pour eux, encore moins les réprimandes des adultes.
A la fin, la réalité et l’imagination convergent dans une scène dramatique, où Jem et Scout eux-mêmes sont attaqués : focalisés sur un personnage bien inoffensif, ils n’ont pas vu venir le danger représenté par un autre homme réellement méchant, humilié par leur père lors du procès, qui veut se venger. En quelques heures, la petite fille frondeuse et insouciante va plus comprendre sur la vie, le monde des adultes, la violence et la bonté qu’en des mois d’école.
Elle va enfin VOIR Boo Radley, dans tous les sens du terme : Comme je le regardais avec étonnement, je vis son visage se détendre lentement. Ses lèvres s’entrouvrirent sur un sourire timide et l’image de notre voisin fut brusquement brouillée par mes larmes.
– Salut Boo ! dis-je.
Quelques mois auparavant, Atticus avait dit à sa fille :
– D’abord, Scout, un petit truc pour que tout se passe mieux entre les autres, quels qu’ils soient, et toi : tu ne comprendras jamais aucune personne tant que tu n’envisageras pas la situation de son point de vue … tant que tu ne te glisseras pas dans sa peau et que tu n’essaieras pas de te mettre à sa place.
En quelques lignes qui m’ont littéralement fait frissonner, Scout se met à la place d’Arthur « Boo » Radley et c’est bouleversant (p. 430-431 dans l’édition du Livre de Poche).
Elle finit par raccompagner cet homme chez lui, par la porte principale. Quand il referme la porte derrière lui, c’est comme si son enfance à elle restait avec lui.
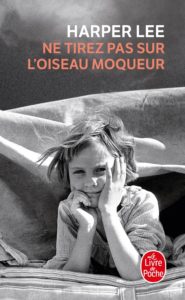
Atticus avait raison. Il avait dit un jour qu’on ne connaissait vraiment un homme que lorsqu’on se mettait dans sa peau. Il m’avait suffi de me tenir sur la véranda des Radley (…)
Boo et moi nous montâmes sur la véranda. Ses doigts trouvèrent la poignée de la porte. Il me lâcha doucement la main, ouvrit, entra et referma derrière lui. Je ne l’ai jamais revu (…) En rentrant à la maison, je me sentis très vieille (…) je pensai que Jem et moi allions encore grandir, mais qu’il ne nous restait pas grand chose à apprendre, à part l’algèbre, peut-être.
Une construction magistrale
La construction de tout le livre est très maîtrisée : les fils de la narration s’enchevêtrent et se promènent tout en étant tenus d’une main ferme par Harper Lee. Chaque scène est vivante, rythmée et enrichit, par touches pastels, délavées ou colorées, l’intrigue. Elles ont toutes leur sens, leur utilité. La scène des rombières de Maycomb venues prendre le thé dans le salon des Finch, présidées par Tante Alexandra, est pittoresque jusqu’au moment où une information, donnée en cuisine, lui donne une tournure sinistre : les rires de ces femmes deviennent alors ricanements de pantins insensibles. Tante Alexandra et Miss Maudie donnent à la jeune Scout une leçon de classe : grâce à elles, la fillette comprend ce que voulait dire sa tante quand elle lui disait qu’il était important d' »être une dame ».
L’image de l’oiseau moqueur revient régulièrement, comme une métaphore perlée, dont Scout elle-même explique le sens à son père, durant le seul moment du livre où on le sent démuni, à la fin. Signe encore une fois que la fillette a mûri et qu’elle a assimilé, en une formule, les leçons d’humanisme que lui donnait Atticus tout au long du livre. Tirer sur l’oiseau moqueur, c’est tuer l’innocence. C’est condamner d’avance ce qu’on ne connaît pas et qui pourtant ajoute de la beauté à la vie.
Les oiseaux moqueurs ne font rien d’autre que de la musique pour notre plaisir. Ils ne viennent pas picorer dans les jardins des gens, ils ne font pas leurs nids dans les séchoirs à maïs, ils ne font que chanter pour nous de tout leur coeur.
Quand on referme le livre, les premières lignes, qui semblent anodines, prennent une signification toute autre, preuve du talent de Harper Lee : la montée en crescendo de tous les niveaux de lecture du roman, du début à la fin, la « petite » comme la grande histoire, sont dignes d’une symphonie.
Atticus Finch, ce héros
La figure du père, droit, intègre, un peu manichéenne, est centrale : c’est l’incarnation du bien et de la droiture, qui inculque à ses enfants, dans des circonstances difficiles, l’importance du courage et d’une conscience claire. Joué par Grégory Peck dans le film produit par Hollywood en 1963 (acteur abonné aux rôles de types biens, comme Gary Cooper), il semble être la figure paternelle idéale pour transformer une charmante sauvageonne en future adulte sensée et respectueuse.
D’ailleurs Jem et Scout se glissent dans la salle du tribunal pour assister aux plaidoiries de leur avocat de père, dans la partie réservée aux Noirs (ce qui ne manque pas de leur attirer des reproches de la part des bien pensants) : ils assistent directement à la violence feutrée des affrontements verbaux, à la tension qui se joue, et comprennent le rôle essentiel de leur père, qui décide de se battre même s’il ne se fait pas d’illusion sur l’issue du procès dans le Sud ségrégationniste.
Vois-tu Scout,il se présente au moins une fois dans la vie d’un avocat une affaire qui le touche personnellement. Je crois que mon tour vient d’arriver. Tu entendras peut-être de vilaines choses dessus, à l’école, mais je te demande une faveur : garde la tête haute et ne te sers pas de tes poings. Quoi que l’on dise, ne te laisse pas emporter. Pour une fois, tâche de te battre avec ta tête … elle est bonne, même si elle est un peu dure.
– On va gagner, Atticus?
– Non, ma chérie.
– Alors pourquoi …
– Ce n’est pas parce qu’on est battu d’avance qu’il ne faut pas essayer de gagner.

Voici deux dialogues entre le père et sa fille, représentatifs des rapports entre eux, faits de pédagogie et de complicité.
– Atticus, tu dois te tromper … ?
– Comment cela ?
– Et bien la plupart des gens semblent penser qu’ils ont raison et toi non …
– Ils ont tout à fait le droit de le penser et leurs opinions méritent le plus grand respect, dit Atticus, mais avant de vivre en paix avec les autres, je dois vivre en paix avec moi-même. La seule chose qui ne doive pas céder à la loi de la majorité est la conscience de l’individu.
– Sais-tu ce qu’est un compromis ? demanda-t-il.
– Une entorse à la loi ?
– Non, c’est un accord obtenu par concessions mutuelles. Voici ce que je te propose : si tu admets que tu dois aller à l’école, nous continuerons à lire tous les soirs comme avant. Marché conclu ?
– Oui, père.
Me voyant prête à cracher, il dit :
– Considérons notre accord scellé sans recourir aux formalités habituelles.
Un roman américain
Encensé dès sa sortie aux États Unis, en 1960, en pleine lutte pour les droits civiques des Noirs, ce livre est passé directement du statut de livre culte à classique étudié dans les établissements scolaires aux USA. Il faut dire que le sujet est éminemment américain.
Oui, mais il est aussi éminemment universel. Alors pourquoi n’est-il pas plus connu en France ? Je n’ai pas d’explications, et je ne peux qu’en recommander chaleureusement la lecture. Roman d’apprentissage, témoignage d’enfant, livre enchanteur et très abouti, « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » fait partie de ces bouquins qu’on ne peut pas lâcher une fois commencé.
NB : Cette chronique a été écrite en parallèle de celle du blog Textualités. Ayant réalisé par hasard que nous lisions Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur en même temps, nous avons décidé de publier nos articles de concert. Je vous invite donc à découvrir l’analyse qu’en fait Anne sur l’excellent blog https://textualites.wordpress.com/ !
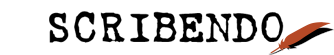
[…] trop heureuse pour ne pas en faire quelque chose d’enrichissant : vous pouvez donc retrouver ici sa […]
Bravo pour cette magnifique chronique, très complète et très détaillée. J’aime beaucoup la lecture que vous avez fait de ce roman-culte, effectivement peu ou pas assez connu en France. Je suis particulièrement sensible à votre analyse du personnage de Boo Radley et de toute la symbolique qui accompagne l’image de l’oiseau moqueur et de l’innocence, thème effectivement développé sous toutes ses facettes dans le roman. Bravo pour votre travail 🙂
Merci Anne ! C’était une expérience très enrichissante et gratifiante d’écrire nos chroniques de concert et d’en découvrir mutuellement les similitudes et différences ce matin. Je ne peux que saluer la finesse et la profondeur de votre analyse https://textualites.wordpress.com/2019/05/20/ne-tirez-pas-sur-loiseau-moqueur-de-harper-lee/comment-page-1/?unapproved=3035&moderation-hash=b4d0580a18bc2090df547a99544d6f35#comment-3035 Longue vie aux oiseaux moqueurs !