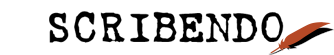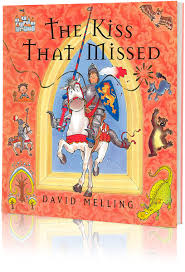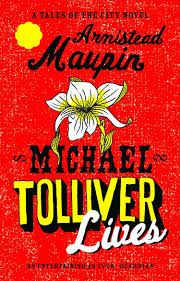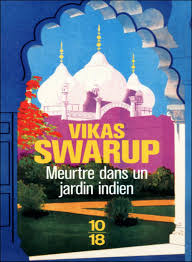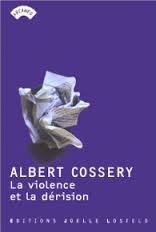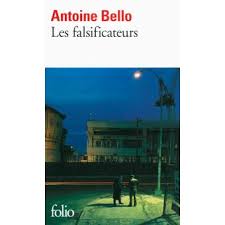Un nouveau storytelling pour une nouvelle ère politique ?
L'avènement de Donald Trump a fait couler beaucoup d'encre et nombreux sont ceux qui ont cherché à comprendre les ressorts qui l'ont amené au pouvoir. Une chose est sûre : son "storytelling", l'histoire qu'il a présentée aux Américains et sa manière de la présenter, a été jugé plus séduisant pour de nombreux électeurs que celui de Hillary Clinton. Et ce malgré les efforts de Michelle Obama, dont le discours "ça suffit !" (dont je parle dans l'article précédent) avait fait date.
Les observateurs ont déjà fait l'analyse de cet animal politique hors norme, parfaitement à l'aise dans une ère étrange, celle de la politique "post vérité", où les faits réels importent moins que l'émotion. Ce qui, au passage, pose de nouveaux problèmes de positionnement aux medias, pour qui le "fact checking", la vérification des faits, est un des piliers de l'existence.

Michelle Obama, reine du storytelling en politique
C’est maintenant la dernière ligne droite : dans 48 heures, les américains et le reste du monde sauront qui présidera à leur destinée pour les quatre prochaines années. Résidant aux États Unis pour quelques jours encore, j’ai souhaité revenir sur ce qui selon moi fut le plus beau moment d’une campagne tendue et éprouvante pour le pays : le superbe discours de la First Lady Michelle Obama, le 13 octobre dans le New Hampshire.
Discours de Michelle Obama dans le New Hampshire le 13 octobre 2016
Abondamment commenté, très admiré, je l’ai écouté peu après sa diffusion, éblouie comme beaucoup d’autres par la qualité et la force de son contenu. Réalisé dans un « swing state » (état indécis, qui « balance » (swing) entre le camp des démocrates et celui des républicains en fonction des élections) à peine un mois avant l’échéance, il fait suite à un épisode particulièrement désastreux pour le camp républicain, avec la diffusion de propos vulgaires et misogynes de leur candidat.
Le discours se montre à la hauteur de l’enjeu et au-delà, pour devenir une référence dans cette campagne brutale :
1/ Michelle Obama oratrice hors pair
Accessible, claire, elle s’exprime sans note pendant 24 minutes sans jamais se laisser déconcentrer ni être dans la connivence déplacée. Elle semble réellement habitée par ce qu’elle dit, ce qui se traduit par une voix qui enfle progressivement, une attitude corporelle ouverte et très droite.

2/ Un modèle de discours
Son propos est parfaitement construit : après avoir « chauffé » la salle, elle s’appuie sur un exemple concret : sa semaine « contrastée » entre la Journée internationale de la fille le 11 octobre, lors de laquelle elle a rencontré des jeunes femmes qui l’ont inspirée par leur courage, et la dernière saillie particulièrement dégradante de l’ « opposant » (dans une campagne saturée de « Trump », elle a l’habileté de ne jamais citer son nom). Elle revient sur cet épisode lamentable pour tisser une double trame : l’affirmation du droit au respect pour les femmes et le soutien à la candidate démocrate Hillary Clinton.
Se servant de « l’opposant » (champ lexical négatif) comme repoussoir, elle dit « ça suffit ! » et décrit avec puissance ce que doit être le futur ou la future président(e) des Etats Unis. On arrive à l’acmé du discours et c’est exactement à son milieu qu’elle clame : cette personne est Hillary Clinton. Maîtrise du temps.
Après un éloge efficace de la candidate démocrate, elle insiste sur l’importance du vote pour stopper le « délire » de l’opposant, pour réaffirmer les valeurs de son pays ridiculisées par cet homme. Elle termine dans la plus pure tradition américaine, avec un «êtes-vous tous avec moi ? » digne d’une superstar en concert et « God bless », dans une ambiance de ferveur extraordinaire.
3/ La politique comme vision de la société
Plusieurs fois dans le discours elle revient sur deux points : l’importance pour les États Unis de garder un rôle de « phare » (également habile car elle chasse sur les terres de Trump dont le slogan est « Make America great again ») et le message à transmettre aux enfants. Elle fait de ce vote un symbole de l’affirmation des valeurs qui, selon elle, ont fait de ce pays une grande nation : le respect pour chaque citoyen, quel que soit son sexe. Elle insiste : la grandeur d’un pays se mesure à la manière dont il traite ses filles et ses femmes. Et elle est stupéfaite que dans son pays, on en soit encore là en 2016. Elle a des mots vibrants pour parler des humiliations subies par les femmes et du courage qu’il faut pour relever la tête en s’impliquant personnellement, en tant que femme, disant à quel point l’attitude de « l’opposant » lui a semblé dégradante, blessante.
Elle est très juste et avisée en associant les hommes à sa réflexion. Pour Michelle Obama, c’est une réduction de la masculinité de considérer les hommes comme des prédateurs. « Les hommes forts n’ont pas besoin de rabaisser les femmes pour se sentir puissants. Les gens vraiment forts tirent les autres vers le haut », ce qui est le cas, dit-elle, de Hillary Clinton.
Donc elle invite chaque citoyen à voter pour Hillary Clinton en insistant sur l’importance du vote de chacun : « We have knowledge. We have a voice. We have a vote ».
Ce discours est celui d’une femme, d’une démocrate, mais aussi d’une très bonne politique. L’avenir dira s’il dessine le début d’une ambition personnelle.
4/ Comment écrire l’histoire américaine ?
La communication politique est storytelling : on raconte une histoire en s’appuyant sur des valeurs, un mythe, une identification, avec les ressorts du théâtre, de l’émotion, de la persuasion. On raconte un récit, voire une épopée.
Michelle Obama maîtrise cet art à la perfection. Face à une campagne qui s’enfonce en-dessous d’un niveau acceptable, elle prend la plume pour écrire une belle histoire : celle d’un pays unifié, qui traite avec le même respect ses citoyens quelque soit leur sexe, qui élit une personne compétente et expérimentée pour conserver son rôle de leader « moral » dans le monde. Elle s’implique personnellement dans cette histoire, décrivant ses propres émotions « It hurts » (« c’est blessant ») et terminant sur une note d’espoir.
Certaines étapes d’une campagne marquent les esprits, constituent une référence – positive ou négative – dans le cours long et tortueux de la démocratie. Ce discours est une référence en la matière. Sera-t-il suffisant pour influer sur le résultat du vote ? Nous serons rapidement fixés.
"A la poursuite du bisou perdu", attention pépite !
Il était un mardi
Once upon a tuesday …
Il était un mardi ...
C’est ainsi que commence « The kiss that missed » (en français : "A la poursuite du bisou perdu") délicieux livre pour enfants écrit et illustré par le britannique David Melling.
Sachant que chaque conte digne de ce nom commence par "il était une fois" / "once upon a time", on assiste, dès la première phrase, à un détournement humoristique des codes littéraires, qui se vérifie à chaque page.
A la recherche du bisou perdu
L’histoire est la suivante : Un mardi soir donc, un roi pressé ne prend pas le temps d'embrasser son fils alors que celui-ci se met au lit. En passant devant la porte de sa chambre, il lui envoie un simple petit bisou.

Mais ce dernier, malicieux et léger, rate sa cible ...

... et s’envole par la fenêtre ouverte, loin dans la nuit étoilée.

Drame.
Hurlements du garçonnet.
Un chevalier pas très dégourdi est sommé par la reine de rattraper le fuyard et de le ramener au château.

Ses aventures seront courtes mais riches en émotions et rencontres typiques : une forêt sombre et froide, des ours, des loups, un dragon.
Sa quête sera-t-elle couronnée de succès ? Ramènera-t-il le bisou tant espéré et le château retrouvera-t-il son calme ?
Doté d’un charme fou, ce livre est un bijou de fantaisie.
Détournement de codes
De fantaisie et de rigueur. Car même s’il se les approprie, David Melling utilise dans cette histoire tous les ingrédients du "schéma actanciel", structure d'interaction formant la trame de tout récit, bien connu des professeurs de français... Le schéma actanciel, mis au point par le linguiste AJ Greimas en 1966, repose sur des piliers aussi vieux que les premières sagas et épopées racontées le soir au coin du feu des grottes humides de Lascaux, Altamira ou Sulawesi, alors que les enfants, bouche bée, écoutaient les récits qui, amplifiés, enrichis, constitueront les prémisses de la tradition orale mondiale, fabuleux réservoir de contes, mythes et légendes.
Faisons un essai de schéma actanciel avec « The kiss that missed". Tout concorde !
Ingrédients du schéma actanciel, tels que vous ne les trouverez pas sur Marmiton.org. Pour cette recette de cuisine inratable - et ses millions de variantes - il nous faut :
|
LES INGRÉDIENTS DU SCHÉMA ACTANCIEL
|
DANS "THE KISS THAT MISSED" |
|
Un héros ou une héroïne (qui ne sait pas encore qu’il/elle est héroïque)
|
Le chevalier sans peur, sans reproche (et avec un trou au pantalon) |
|
Le destinateur ou émetteur : ce/celui/celle qui sollicite le héros.
|
La mère du prince, qui ordonne au chevalier sus-nommé de quérir le bisou |
|
La quête : sollicité par le destinateur, le héros part en quête de quelque chose. Un objet, une personne, un statut … la quête métamorphose le héros, lui donne son essence. Mais tout ne va pas sans mal. |
La quête est ici, bien entendu, le fait d’attraper le royal bisou |
|
Le destinataire : La personne qui va être bénéficiaire de la quête du héros.
|
Le petit prince bien sûr ! |
| Les opposants : tous les obstacles sur la route du héros. |
David Melling a mis le paquet : ours, loups, neige, obscurité, dragon, vide : toutes les peurs d’enfance ou presque sont réunies en deux pages !
|
| Les adjuvants : ceux qui facilitent la quête. | Paradoxalement, le bisou et le dragon s’avèrent être de bons adjuvants. Le premier car il endort ou calme les bêtes féroces lors de son passage (les loups se mettant à lire une histoire des trois petits cochons) et se cache dans la narine du dragon. 
Le deuxième car il se révèle affectueux compagnon, ramenant son petit monde (chevalier, cheval, bisou dans son filet à bisous) sur un seul de ses doigts griffus. |
La communication et les contes : c'est pareil !
Cette base, simple et rigoureuse, est la trame autour de laquelle s’enroulent les fils de toute histoire structurée, qu’elle soit conte, poème épique, essai, non-fiction …C’est la trame de la vie et de son mouvement, qui peut se transposer dans de nombreuses situations, et dans tout ce qui relève de la narration, de la présentation. Voilà pourquoi l’univers de la communication professionnelle s’en est naturellement emparé. La communication mise sur l'efficacité dans la manière de présenter les choses, de manière à atteindre son audience (sa cible, son auditoire, son destinataire, bref, l'autre). Et en l'occurrence le récit, la saga sont des vecteurs mille fois plus efficaces que n’importe quel discours institutionnel ou catalogue d’intentions.
Pourquoi ? Parce qu'ils font appel aux émotions, aux sens, au plaisir, à l'identification, et non à la raison seule. Une communication bien travaillée s'appuie sur les mêmes ressorts que ceux des contes traditionnels, des épopées, des romans policiers. Ces ressorts sont ceux de la mise en récit ou "storytelling", qui s'inspire beaucoup du schéma actanciel. Après tout, raconter c'est communiquer, et communiquer c'est raconter. Les livres pour enfants sont de très bons exemples de ce cadre rigoureux, au sein duquel peut s'épanouir l'imaginaire. Leur structure est même si puissante qu'elle a réussi à restituer et canaliser de manière symbolique les peurs primitives de l'enfance - et de l'âge adulte. Si puissante que la répétition propre au genre l'enrichit : il n'y a qu'à voir les yeux des enfants lorsqu'on raconte pour la 50e fois le même conte, qu'ils connaissent par coeur, anticipant déjà le plaisir qu'ils auront lors de la chute ou de tel ou tel passage.
Alors laissons l'histoire où nous l'avions laissée, au moment où dragon, chevalier, cheval et bisou rentrent gaillardement au château et reprenons tout depuis le début :
Once upon a tuesday ...
Arrêt sur images - scène finale du film In the mood for love
Still words
De temps en temps je me baladerai, dans ce blog, sur d'autres sentiers que les chemins littéraires. Cette fois-ci j'arpente les allées d'un film qui avait marqué les esprits lors de sa sortie en 2000, avec un arrêt sur sa dernière scène, d'une beauté poignante.
Une scène toute en retenue, comme l'est le film entier : dans le silence à peine troublé par le vent, un temple cambodgien, le ciel, un moine bouddhiste, des jeux de lumière éblouissants.
Un trou, dans la pierre du temple, est filmé comme la bouche immobile d'un masque de théâtre grec antique. Un homme s'approche, place ses mains contre le trou de pierre et parle longtemps … Confidences muettes, couvertes par une musique au violoncelle. L'homme repart. De longs travellings englobent la beauté immuable du paysage indifférent. On revoit le trou, cette fois bouché par un peu d'herbe, dérisoire serrure.
Durant le film, l'homme avait expliqué à la femme qu'il aimait la tradition suivante : autrefois, pour préserver un secret, les gens allaient dans la montagne, creusaient un trou dans un arbre, disaient ce qu'ils avaient sur le coeur et scellaient leurs paroles à jamais en bouchant le trou avec de la terre.
Avec cette scène finale, allégorie poétique de l'incommunicabilité, Wong Kar Wai achève une œuvre à la grande beauté formelle, qui magnifie une histoire triste. Une histoire plus rêvée que vécue, dont il ne reste comme unique trace qu'un murmure, chuchoté à la pierre d'Angkor Vat.
Arriver à réaliser une scène pareille, aussi simple, dépouillée et émouvante, est la preuve d'une grande maîtrise de son art. Au tournant du siècle, le réalisateur hongkongais était au sommet de ses capacités et le prouvait magistralement.
Michael Tolliver est vivant, par Armistead Maupin

Une chronique de San Francisco
Il y avait si longtemps que je ne m'étais pas immergée dans les merveilleux Tales of the City ou Chroniques de San Francisco, d'Armistead Maupin. Pas merveilleux dans le sens « extraordinaires » ou irréalistes, mais plutôt dans le sens où ils regorgent de vie, de finesse d'observation et - mot galvaudé – de résilience.
Michael Tolliver, héros et narrateur, est un des personnages qui peuplent ces contes de la baie, avec Mary Ann, Brian, Anna Madrigal … certains ont disparu, depuis le premier tome et le terrible virus qui a décimé une partie de la communauté gay de San Francisco, les autres sont là, bien vivants, avec leurs casseroles, leurs regrets, leur gloire et leur attachement mutuel.
28 Barbary Lane / le reste du monde
Le premier tome, paru il y a presque vingt ans, narrait l'arrivée de Mary Ann, jeune provinciale fraîchement débarquée de son Ohio natal et sa découverte d'une autre manière de vivre à San Francisco, l'une des villes les plus avant-gardistes du moment. Dans la pension tenue par Anna Madrigal au 28, Barbary Lane, elle faisait connaissance avec une galerie de personnages en marge de la vision traditionnelle de l'American Way of Life.

Nous sommes à présent en 2006. Michael Tolliver, à l'époque jeune homosexuel diagnostiqué séropositif, craignait d'être emporté par la maladie. Les années ont passé et grâce au traitement, « Michael Tolliver est vivant » et bien vivant.
Agé maintenant de 55 ans, marié à Ben, il est confronté aux mensonges de sa famille bien pensante de Floride, dont il a toujours été le vilain petit canard, et la vieillesse de sa mère de cœur, Anna.
Question de normes
A l'ouverture d'esprit, à la sensibilité de cette dernière s'opposent les crispations des frère, mère et belle-soeur qui n'assument toujours pas, des années après, l'homosexualité de Michael.
Au-delà du destin de cet homme, "Michael Tolliver est vivant" est un hymne à l'affirmation de soi, à tracer son propre chemin sans faire des normes sociales sa seule boussole. Ce qui ne va pas sans douleur.
Le rejet par sa mère - jusqu'à l'acceptation finale, qui vient trop tard selon lui - son refus d'aimer son fils comme il est, a été source d'une souffrance constante dans la vie de Michael, souffrance à laquelle il a dû faire face et gérer à sa manière. La résilience qu'il a développée à ce sujet est décrite dans un court dialogue entre le protagoniste et son époux, vers le milieu du livre, alors que la mère est mourante :
- Les gens disent toujours : "mais bien sûr que tu l'aimes, tu dois l'aimer, c'est ta mère", mais cette sorte d'amour peut mourir aussi facilement que les autres. Il doit être nourri pour vivre.
- Elle t'aime, Michael
- Pas suffisamment pour remettre en cause ce qu'on lui a inculqué (...) je l'ai laissée partir il y a longtemps. Mon deuil est fait, déjà.
Sous la plume de Maupin, les freaks, les décalés sont ceux qui vivent selon les préceptes exacts du conformisme intolérant et paternaliste au possible de la famille de Michael, symbolisés par le petit théâtre de poupées ridicule que sa belle-soeur trimballe partout avec elle pour purifier les âmes, véritables masques de vertu que la mère, dans un sursaut de vérité et de dignité, balance à la face de sa bru.
A l'inverse, il décrit avec grâce chaque situation de sa vie d'homme gay, ayant choisi sa famille et gagné son équilibre sans l'aide des liens du sang.
Du grand art !
Armistead Maupin illumine par sa finesse d'observation des scènes banales et arrive à rendre avec justesse des émotions ténues, fragiles ou précieuses.
From this distance the pounding music in the Full Moon sounded almost bittersweet, like an orchestra heard across a lake. The actual moon was far from full – just a little nail paring caught in the branches – but it was lovely.
(...)
- Qu'est-ce qui te fait penser à Mona ?
- La joie que je ressens, je pense. Tu me ramènes à mes meilleurs moments. Je me sens connecté à eux, à nouveau (c'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Je méditais également sur la douleur de l'impermanence)
Comment arrive-t-il à bâtir, chronique après chronique, cet univers planté sur la baie de San Francisco, cathédrale en papier faite de multitudes d'instants capturés, de sensations et d'émotions qui nous rendent proches ces personnages, leurs doutes, leurs arrangements avec la vie, leur courage aussi ?
Chacune de ces chroniques est une leçon pour un apprenti écrivain : sa science des dialogues, la gravité sous la légèreté, le rythme, l'attention portée aux détails… Ce livre est une célébration de la vie, quoi qu'elle nous apporte. Parlant d'un miraculé, écrit par un auteur lui-même éprouvé, le titre est une affirmation crâneuse et pleine de joie : Michael Tolliver est vivant.
Il a écrit un nouvel opus depuis, Anna Madrigal. Un beau plaisir de lecture en perspective.
Meurtre dans un Jardin indien, de Vikas Swarup
L'intrigue de « Meurtre dans un jardin indien » est simple et savamment construite : un riche jeune homme, beau et complètement pourri, se fait assassiner lors de la garden party organisée chez lui pour fêter son propre acquittement pour meurtre (il a tué quelques temps auparavant une jeune serveuse et son père, ministre de l'Uttar Pradesh, l'a tiré d'affaire). Il y a six suspects, six mobiles, six alibis.
C'est le point de départ d'un livre opulent, passionnant, drôle et grave : « Une bombe déguisée en feu d'artifice » prévient la quatrième de couverture, citant Philippe Chevilley, des Echos.
Feu d'artifice, oui ! Celui d'une narration maîtrisée à la perfection : les fils s'entremêlent sans effort apparent, formant un canevas serré. L'histoire se construit, chaque témoignage éclaire les faits et dévoile un peu plus la réalité bigarrée d'un pays-continent, flamboyant, misérable et fascinant, tout en enrichissant l'intrigue policière et ses rebondissements.

Ce portrait en technicolor de l'Inde d'aujourd'hui imprime intérieurement la rétine, alors que l'on absorbe toutes ces couleurs, ces images. Le risque aurait pu être d'en faire trop, de gaver le lecteur avec une matière surabondante, mais Vikas Swarup tient un bon équilibre entre gravité, humour, ironie, flamboyance, réalisme et merveilleux. Il utilise la liberté de l'écrivain avec virtuosité et à propos, n'hésitant pas à se servir d'un spectacle de spiritisme raté comme subterfuge à l'incroyable – et aléatoire – transformation mystique d'un notable corrompu en Mahatma Gandhi himself. Cette anecdote utilise avec malice et finesse les clichés les plus éculés sur l'Inde, ses maîtres spirituels plus ou moins labellisés et sa figure tutélaire de la non-violence.
Les six suspects illustrent le pays actuel et sa diversité sociale, sexuelle, économique, avec des moments poignants ou hilarants. Certains personnages sont savoureux comme Larry Page, l'américain légèrement abruti et complètement inculte, homonyme du patron de Google, qui débarque en Inde à la recherche de l'épouse idéale. Après avoir travaillé dans un centre d'appels où son accent américain fait merveille et s'être fait capturer par des terroristes religieux pris d'assaut par le FBI, il finit par trouver la perle rare !
Dans la riche galerie de personnages, mes deux préférés sont Shabnam Saxena et Eketi.
Shabnam Saxena est le nom de scène d'une starlette bollywoodienne, intelligente et ambitieuse. Effaçant son passé d'anonyme provinciale – mais ne parvenant pas à l'oublier – elle tente de construire son destin en contrôlant son entourage et chacune de ses actions. Elle croit maîtriser les règles de son jeu, mais l'apprentie Pygmalion se fait à son tour manipuler par son assistant et une jeune sosie carriériste et sans scrupules. Une épreuve décisive va à la fois la révéler à elle-même, la rapprocher de sa famille et changer radicalement le cours de son existence. Tous les masques tombent... ou presque. Shabnam Saxena est le type même de la jeune femme qui a compris les rouages d'une société dure et se sert de ses armes – intelligence et beauté – pour ne pas être écrasée.
Eketi est, d'une certaine manière, son opposé. Habitant une île reculée, ne connaissant rien aux codes du monde moderne, il oppose à la société des apparences sa pureté et son intégrité. Considéré comme laid, victime de racisme, il cherche à comprendre les gens qu'il rencontre avec candeur et sagesse et touche ceux que la société ne voit pas, mais qui ont appris, à leurs dépens, à voir au-delà des apparences : Dolly, le « hijra », paria au corps d'homme et à « l'âme de femme » et Champi, la jeune aveugle au visage monstrueux, déformé par la catastrophe de Bhopal. L'amour de Champi et Eketi, touchant et magnifique, semble sorti d'un « sequel » du Petit Prince, tellement ils illustrent la fameuse citation : « on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ».
Signe d'un certain pessimisme – réalisme ? - de l'auteur, le personnage le plus pur de l'histoire connaît une fin tragique, presque expiatoire. L'inspecteur de police l'avait prévenu : « Nous habitons un pays étrange et sublime. On y rencontre les êtres humains les meilleurs, et aussi les pires. On peut aussi bien y avoir affaire à une générosité sans pareille qu'à une cruauté qui dépasse l'entendement. Pour survivre ici tu dois changer ta façon de penser ».
Il n'y est pas parvenu, il n'a pas survécu.
Car le feu d'artifice cache une vraie bombe : page après page, le monde s'offre dans un spectacle peu reluisant : des politiciens corrompus, un fils à papa profitant de son statut pour humilier et violer, des notables infects et suffisants... Mensonges et manipulation semblent les seuls moyens de s'en sortir dans une société dure et hypocrite, particulièrement pour les femmes, comme le résume Shabnam Saxena d'une formule lapidaire : « l'épouse peut être séduite, la putain achetée ».
L'ambivalence de la dialectique maître-esclave, où chacun tente de tirer parti de sa situation dans une société très hiérarchisée est rappelée plusieurs fois : dans le rapport entre Mohan, le notable irascible touché périodiquement par la grâce et son serviteur qui ne vit que pour marier sa fille, ou dans les rapports troubles entre Shabnam Saxena, son sosie Ram Dulari et son assistant véreux Dhola.
Dans une pirouette finale, l'auteur rappelle, en citant Nietzsche, qu' « il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations ». Qui a tué ? Quelle est la réalité ? Où est la vérité ? Il y autant de possibilités qu'il y a de facettes aux boules brillantes décorant la maison de l'affreux Vicky Rai le soir de sa mort.
Albert Cossery, le dandy à rebours
Les livres d'Albert Cossery sont uniques. Je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu trois : Les Fainéants dans la Vallée Fertile, La violence et la dérision, Un complot de saltimbanques, il y a 20 ans. Je découvrais alors d'autres manières de penser.
Son style, à la fois coloré, ironique et implacable, tient l'émotion à distance. Maniant la dérision et la compassion dans une même phrase, il a bâti une œuvre profondément originale, à contre-courant de la plupart des publications actuelles. Dans ses livres, l'oisiveté est élevée au rang d'idéal vécu, le travail est vu comme la pire des aliénations, la liberté se trouve dans le dénuement. Ces thèmes, enrichis et approfondis au fil du temps – un livre par décennie, une ligne par jour, tel était son rythme – n'étaient pas une posture littéraire. Albert Cossery, dandy à rebours originaire du Caire, débarqué à Paris à trente-deux ans en 1945, a passé la majeure partie de sa vie à observer l'existence à la terrasse des cafés de Saint Germain des Prés. Riche de quelques vêtements et d'une théière, il fut pensionnaire du même hôtel pendant des années, voyageant dans sa chambre. Ses personnages, hauts en couleur, princes sous leurs haillons, d'une dignité décelable à chaque phrase, s'interrogent l'air de rien sur la vie. J'ai beaucoup aimé découvrir cet auteur provocateur, son audace tranquille, la puissance de son style et sa philosophie radicale, qui a élargi mes horizons de pensée. Un bémol : son traitement caricatural des personnages féminins, tantôt objets de désir pour les hommes, tantôt source d'emmerdements infinis, jamais vus comme des sujets capables d'action ou de pensée. Faut-il en conclure qu'Albert Cossery ne s'adressait qu'à la moitié de l'humanité ? Puisque les livres échappent à leurs auteurs, cette question n'a plus d'importance.
|
|
 |
|
« Je ne peux pas écrire une phrase qui ne contienne pas une dose de rébellion. Sinon elle ne m'intéresse pas. »
Réalité augmentée
Aujourd'hui je parle de deux livres inventifs, Les Falsificateurs d'Antoine Bello et L'Affaire Jane Eyre de Jasper Fforde. Tous deux ont en commun de jouer avec notre perception de la réalité, en proposant des univers à la fois structurés et décalés.
Les Falsificateurs
J'ai commencé il y a quelques jours Les Falsificateurs, roman conseillé par mon amie libraire Emma. J'ai lu une centaine de pages et j'adore. Pitch de base : le narrateur, Sliv, jeune homme débrouillard et idéaliste, terminant ses études de géographie, est embauché pour un salaire superbe dans un cabinet d'études environnementales. Cet emploi est une couverture, il le découvre bien vite, son véritable job étant de falsifier la réalité, réécrire des petits bouts d'histoire officielle, pour le compte d'une mystérieuse entreprise, le CFR : Consortium de Falsification du Réel (on s'y croirait).
J'en suis à sa première tentative de falsification de la réalité, sous la houlette de son mentor, Gunnar. Les dialogues sont vivants et, pour l'instant, l'intrigue très bien plantée. J'imagine que je ne suis pas au bout de mes surprises et je m'en régale d'avance.

En voici deux extraits :
« Vous devez répondre à deux questions importantes. Que voulez-vous faire de votre existence ? Et saurez-vous vivre avec le poids du secret ? Prenez le temps de réfléchir ; je ne vous attends pas au bureau avant lundi prochain ».
Gunnar insista également pour que je fabrique moi-même la majorité de mes sources . « De plus en plus de jeunes agents, déplora-t-il, pensent qu'il leur suffit de modifier un nom ou un chiffre dans des bases de données pour accréditer leur scénario. Ils commettent là une profonde erreur. L'altération, pour nécessaire qu'elle soit parfois, ne saurait se substituer à une bonne source ad hoc. C'est ce qu'a compris Lena Thorsen quand elle a créé cette association pour la culture thessalique et décidé d'en rédiger les minutes sur vingt ans. Quelle meilleure façon de camper des personnages, d'installer une chronologie ? Un bon agent contrôle ses sources, voilà ce que nos jeunes recrues, sans doute effrayées par le travail considérable que représentent ces créations ex nihilo, oublient trop souvent.
L'Affaire Jane Eyre
Lire Les Falsificateurs m'a rappelé un autre roman découvert il y a quelques années, L'Affaire Jane Eyre, qui lui aussi manipule la réalité, mais de manière différente. Dans Les Falsificateurs, le narrateur se voit proposer le rôle de créateur, de démiurge, avec tout ce que cela a d'excitant et de vertigineux. Il dispose, grâce au CFR, d'un arsenal d'outils pour parvenir à ses fins : falsification de sources, inventions de pièces, recréation de souvenirs, même un "bureau des Légendes" pour les créations de personnages. Pourquoi doit-il faire cela? Pour qui ? On ne le sait pas. Pas plus qu'on ne sait où commence ni où s'arrête la réalité. Sacré tour de force.
Dans L'Affaire Jane Eyre, de Jasper Fforde, les choses sont posées plus clairement : on est dans un monde qui ressemble au nôtre, mais avec des différences notables, proposées dès le départ par l'auteur : Fforde a fait en amont le boulot que le CFR demande à Sliv...
Nous voici donc dans l'Angleterre de 1985. Le pays est toujours en guerre contre la Crimée - depuis 130 ans - les gens se baladent en dirigeables et le Pays de Galles est indépendant. L'héroïne, Thursday Next (elle-même vétéran de la guerre de Crimée) se balade dans les pages du célébrissime roman Jane Eyre, à la poursuite d'un méchant prénommé Achéron Hadès, en profite accessoirement pour changer la fin du livre de Charlotte Brontë, fin qui de toute manière ne convenait à personne, et retourne périodiquement dans le monde réel pour les repas de famille ou retrouver son ancien fiancé. La fin est une mise en abyme sympathique de l'histoire de Jane Eyre.
Il faut s'accrocher tellement l'auteur a d'idées mais son univers parallèle totalement assumé, fait de fans de littérature et de cassures spatio-temporelles, m'a charmée avec ses trouvailles originales. Un univers où la question de la paternité des œuvres de Shakespeare fait l'objet de règlements de comptes entre gangs, où l'on passe des livres au monde réel via d'ingénieux stratagèmes.
Le genre de livre dans lequel je barbote avec délectation.
Extrait :

- Qui êtes-vous, nom de Dieu ? Demanda Hobbes.
Elle le gifla violemment ; il chancela avant de se ressaisir .
- Je m'appelle Grace Poole. Je ne suis peut-être qu'une servante, mais vous n'avez pas le droit de prononcer le nom du Seigneur en vain. Je vois à votre accoutrement que vous n'êtes pas d'ici. Que voulez-vous ?
- Je viens, hum, de la part de Mr Mason, bredouilla-t-il
- Foutaises, rétorqua-t-elle d'un air menaçant.
- Je veux Jane Eyre.
- Mr Rochester aussi, répondit-elle, placide. Mais il ne l'embrasse même pas avant la page cent quatre-vingt-un.
Hobbes jeta un regard dans la chambre. La folle était en train de danser en gloussant, pendant que les flammes s'élevaient en hauteur sur le lit de Rochester.
- Si elle tarde à venir, il n'y aura pas de page cent quatre-vingt-un.
Pas de limite à l'imagination !
Ces deux livres laissent une place de choix à l'imaginaire et font preuve d'une grande inventivité : création d'un univers cohérent et maîtrisé, mises en abyme, réflexion sur la création littéraire et la perception du monde, tout ceci dans un style vivant, avec des personnages qu'on a plaisir à suivre.
L'écrivain haïtien Gary Victor affirme qu'il accorde plus d'importance au récit qu'au style (après avoir lu quelques extraits de son livre Le sang et la mer je trouve pourtant qu'il a un style magnifique, très riche) : « Quand on me dit en France que Gary Victor a une belle écriture, je préfère les Anglais qui diraient : « tu crées de belles histoires, de bons personnages et de bons univers ».
Pour lui il est primordial de laisser de la place « à l'imaginaire, au récit ».
J'adhère. J'ai beaucoup plus d'admiration pour un auteur au style bon voire très bon sans être flamboyant, qui m'embarque dans son histoire, qui me fait croire à son livre, plutôt que pour un virtuose de la prose encombré par son ego. Le style pour le style ennuie et ne va nulle part.
En outre, ce genre de livre encourage les apprentis écrivains. Ils donnent l'impression qu'avec de la persévérance, on peut arriver à créer une histoire de bout en bout, avec ses propres personnages et dialogues, son rythme et sa cohérence … C'est l'Internationale des livres, organisation invisible où les ouvrages existants encouragent ceux à venir.
Le Voyage de l'Éléphant de Jose Saramago
L'éléphant et sa troupe
Au seizième siècle, un pachyderme traverse la moitié de l'Europe, escorté par un bataillon d'humains peu habitués à ce genre de mission. Déplaçant son impressionnant gabarit de montagnes en plaines, l'animal a des préoccupations (brouter, se dégourdir les pattes, se reposer) en total contraste avec les enjeux politico-militaires qui entourent son périple de 3000 kilomètres. Car l'éléphant est un cadeau de poids, fait par une tête couronnée espagnole à une future tête couronnée autrichienne.
Ce décalage entre l'apparente indifférence du « personnage » principal et les considérations humaines nous vaut des scènes picaresques ou irréelles et crée un ressort comique qui court tout au long du livre, l'éléphant semblant parfois la seule réalité tangible de l'histoire (sauf quand il disparaît dans le brouillard).

Un écrivain au sommet de son art
Ce livre m'a énormément plu, pour deux raisons principales : son humour discret et omniprésent, et son style éblouissant.
Saramago arrive à construire un récit rigoureux, vivant, pittoresque, à partir d'une intrigue somme toute assez mince, même si elle est originale, toute entière contenue dans le titre : il raconte « le voyage de l'éléphant ».
Autre constat : il manie la langue avec une virtuosité impressionnante. Je n'aime pas d'habitude les séquences narratives interminables, ou présentant une ponctuation aléatoire. A quelques géniales exceptions près (dont Flaubert et certains passages d'Albert Cohen), je trouve que cela cache souvent un manque de rigueur dans le style. Less is more. Mais nous sommes ici dans un jeu de langue maîtrisé, où rien n'est laissé au hasard. Les phrases immenses donnent une impression d'espace infini, écho stylistique aux terres inconnues traversées par l'éléphant et son cortège bigarré.
Les meilleurs livres, selon moi, sont ceux qui laissent une impression. Banalité certes, mais vérifiée à chaque fois. Certains ouvrages écrits avec beaucoup de talent et de savoir-faire ne m'ont laissé aucun souvenir. D'autres m'accompagnent depuis des années et les re(re-re-re)lire ouvre à chaque fois une fenêtre, petit monde que je porte à l'intérieur. Ils créent des associations de pensées fortes et durables.
Correspondances
Je ne suis pas une fan des pages de description. Mais l'écriture du groupe, hommes et animaux, se perdant dans la brume pour réapparaître ensuite, tels un point d'interrogation flottant à la surface des choses, est d'une grande puissance narrative. Ces pages mystérieuses, où la littérature m'emporte, font écho à une musique que j'écoutais enfant : « Dans les steppes de l'Asie Centrale » de Borodine. J'adore le début, encore plus la fin, avec les notes fragiles tenues par le violon et la flûte, en diminuendo, jusqu'à devenir silence, comme une caravane disparaissant dans la brume ou la poussière des steppes. J'ai voyagé très loin dans le canapé de mes parents au son des Steppes de l'Asie Centrale. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde et vécu plusieurs vies avec certains livres, dont Le Voyage de l'Éléphant.

Mystery Train
Au bout de la rue, une trouée dans les arbres.
Un quai en bois clair se devine. Puis des rails, dessinant une ligne sinueuse au milieu de joncs, de nichoirs à faucons, de poches d'eau salée, jusqu'à se perdre au loin, dans une forêt encore à peine feuillue. Une voie ferrée ici ?
Juste à ce moment-là, comme en réponse à nos interrogations, surgit du fond du cadre, à toute vapeur, un petit train rouge, brillant, lustré. Tchou tchou ! Stoppe pile au niveau du quai. En sort un ample conducteur, avec casquette bleue s'il vous plaît, occupé à crocheter le câble de son antique trolley au fil électrique surplombant la ligne. « Wanna come in ? »
Et hop, nous voici dans la place, l'unique compartiment pour nous seuls, entretenu avec soin, banquettes en osier serré, vernis, publicités des années 40 et 50 et éclairage à l'ampoule ronde. Un dernier coup de sifflet, c'est parti pour une balade hors du temps, deux ou trois kilomètres dans une nature étonnante, marais, bras de mer, bois et petites collines granitiques. Direction l'entrepôt. Deux ou trois plaisanteries avec les collègues, revérification du crochet sur le fil électrique, nous voici repartis dans l'autre sens. Marais, petit pont, vols d'oiseaux majestueux, on freine, et on saute sur le quai en bois clair. On remercie, et le voilà qui s'éloigne à nouveau en chantant du sifflet.
Depuis je vérifie chaque jour que le quai en bois est toujours au bout de la rue, mais le petit train n'est jamais revenu. A quelques encâblures de là s'épanouissent autoroutes à huit échangeurs, centres commerciaux ouverts 24/24, docks pétroliers et maisons individuelles.
Et tout près, l'immense océan qu'on entend respirer la nuit, si on coupe le moteur et qu'on s'approche assez.